humour image vie monde roman amour chez france photo belle travail histoire dieu musique nature nuit jeux fleurs art bleu humour littérature voiture livres anges paysage coeurs poème actualité poésie poème
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· DIAPORAMA-PPS (817)
· ARTS ORIGINAL (1498)
· ARTISTES PEINTRES-DESSINATEURS (1156)
· PHOTOGRAPHES CONFIRMES (1388)
· ANIMAUX DIVERS (1161)
· MON AMI CLAUDE-VIDEOS-BLOGUES (1984)
· CHANSON-UNE CHANSON UNE HISTOIRE (923)
· MON AMIE MONIQUE D.-VIDEOS-BLOGS (1795)
· HUMOUR SEXY-BLAGUES (299)
· PARIS LIEUX ET MONUMENTS (1025)
bravo madame enfin libre !! http://photoco smos.centerblo g.net
Par photocosmos, le 09.11.2025
bonne pioche ! http://photoco smos.centerblo g.net
Par photocosmos, le 09.11.2025
ce serai bien dommage encore la culture qui disparait ,faut voir le ministere de la culture rachida dati.... h
Par photocosmos, le 09.11.2025
elle a fait l'effort de croire et a reussi ! http://photoco smos.centerblo g.net
Par photocosmos, le 09.11.2025
c'est grandiose ,impossible en france tant chacun se bat pour son loping de terre ,bravo l'espagne http://phot
Par photocosmos, le 09.11.2025
· RETROUVEZ VOTRE PHOTO D'ECOLE
· PERE NOEL ET L'HUMOUR
· LES PLUS BEAUX VILLAGES D'ITALIE
· UNE CHANSON COQUINE
· humour sexy
· BERNARD BUFFET PEINTRE FRANCAIS-1
· DESSINS COQUINS SEXY HUMOUR
· POEME DE JACQUES CHARPENTREAU
· COLLECTION VETEMENTS POUR CHATS
· Nadine Morano filmée en plein ébat sexuel
· NAZARE AU PORTUGAL
· HUMOUR HI HI LES 10 COMMANDEMENTS CORSES
· TAJ MAHAL HISTOIRE
· alison botha miraculée !
· LES PLUS BEAUX YEUX DU MONDE-1
Date de création : 20.01.2011
Dernière mise à jour :
10.11.2025
49308 articles
Histoire de la poésie à travers les siècles
Histoire de la poésie à travers les siècles
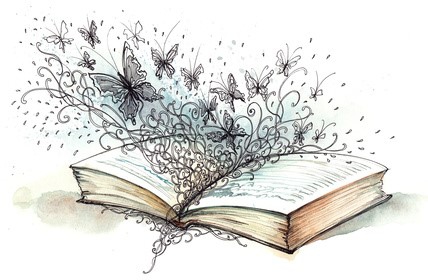
Pendant l'Antiquité grecque
Le mot « poésie » vient du grec « poiein » qui veut dire « fabriquer, créer ». Le poète est appelé « aède » ou « rhapsode » selon s'il crée et compose ses poèmes ou s'il se contente de réciter ceux des autres. Le poète créateur est donc « l'aède ». Il est considéré comme habité par le souffle divin, une sorte d'intermédiaire entre les dieux et les hommes.
L'aède n'écrit pas en vers mais compose ses textes en suivant une unité rythmique appelée le dactyle ou l'iambe, selon la combinaison retenue de voyelles longues et de voyelles brèves. A cette époque, la poésie est en effet scandée, c'est-à-dire prononcée d'une manière à marquer les temps forts, ce que la langue grecque permet.
La poésie se retrouve dans tous les genres littéraires : les épopées comme l'Iliade et l'Odyssée créées par l'aède Homère ; les poèmes lyriques de Sappho ou Pindare par exemple ; les Fables d'Esope ; les tragédies d'Eschyle, de Sophocle ou d'Euripide ; les comédies d'Aristophane ou de Ménandre.
Calliope, muse de la poésie par Eustache Le Sueur
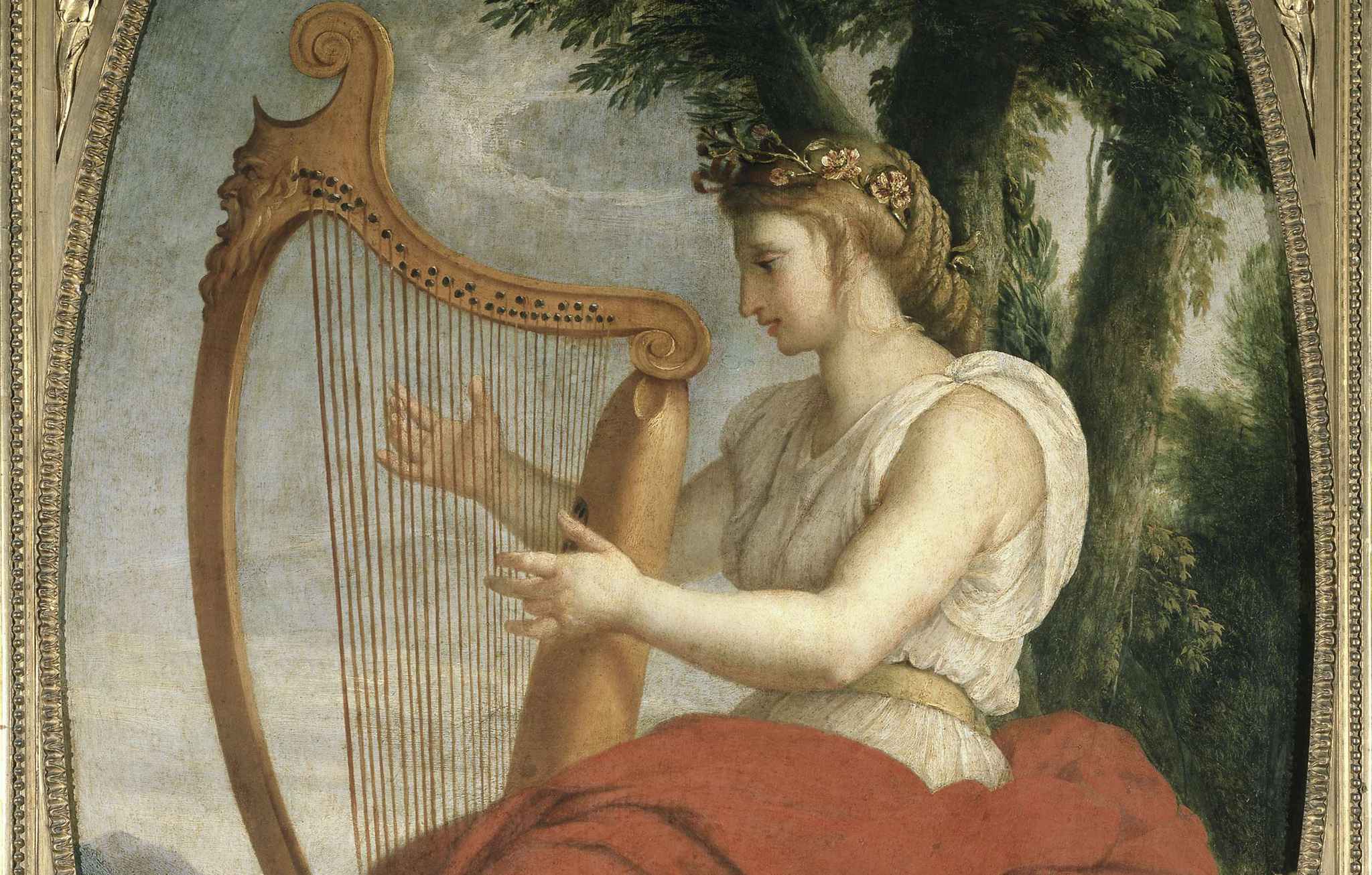
Pendant l'Antiquité latine
Le poète est nommé « poeta » s'il est artisan du vers ou « vates » s'il est considéré comme une sorte de prophète inspiré par les dieux. Le vers latin imite le vers grec, toujours basé sur le rythme et la longueur des voyelles car la langue latine le permet autant que le grec ancien.
Parmi les poètes latins on peut citer Virgile, Ovide, Horace et Juvénal, sans compter les poètes-dramaturges tels que Sénèque qui compose des tragédies ; Plaute et Terence pour les comédies.
Au Moyen Age

Au Moyen Age, il existe trois types de « poètes » : les jongleurs, les troubadours et les clercs.
Les jongleurs sont des amuseurs itinérants qui distraient de grandes assemblées en racontant des histoires rédigées en vers. Au cours du Moyen Age, ces jongleurs finissent souvent par se sédentariser auprès d'un seigneur. On les appelle alors des ménestrels.
Les troubadours composent des poèmes lyriques et s'accompagnent d'un instrument de musique. Ces types de poètes apparaissent dans le sud de la France puis remontent au nord, où leur poésie se développe. Au nord, on les nomme alors des trouvères.
Les clercs ont fait des études : ils connaissent le latin et créent des poèmes et des récits en vers selon des techniques soignées de composition.
La langue française ne présentant pas cette particularité de longueur de voyelles caractéristique de la poésie grecque ou latine, le poète français choisit de s'exprimer en vers réguliers, c'est-à-dire en adoptant des vers toujours de même longueur, selon un nombre fixe de syllabes : des octosyllabes ou des décasyllabes. Un poème fait exception à cette époque : le Roman d'Alexandre, en douze syllabes. On appellera alors ce vers de douze syllabes un « alexandrin ».
Au début, les vers ne sont pas forcément des vers rimés : ils sont plutôt marqués par une assonance c'est-à-dire par un son voyelle répété dans la syllabe finale. Puis de plus en plus de poètes choisissent de s'exprimer en vers rimés, avec des rimes suivies.
Petite précision : la poésie concerne au Moyen Age non seulement les poèmes mais aussi les romans, écrits eux aussi en vers et en rimes suivies. Le roman Tristan et Yseut est par exemple composé en octosyllabes et en rimes suivies.
A la fin du Moyen Age, l'usage de l'alexandrin en vers rimés avec des rimes suivies se généralise.

Au XVe siècle
En poésie on peut retenir deux noms de cette époque : le prince Charles d'Orléans et le poète François Villon, qui écrivent surtout des rondeaux et des ballades. Dans ces textes souvent à caractère autobiographique, il est question d'amour, de la nature, du temps qui passe, de Dieu, et en plus chez Villon d'une certaine insolence et d'un sentiment de révolte.
A la fin du XVe siècle – début du XVIe siècle, des poètes s'amusent à jouer avec la langue française et surtout avec les sonorités. On les nomme « les grands Rhétoriqueurs ».
Au XVIe siècle
Ce siècle célèbre d'abord la poésie de Clément Marot empreint de légèreté voire d'humour. En marge de la poésie de Cour, attachée à un prince, naît également une poésie lyonnaise lyrique avec Louise Labé et Maurice Scève par exemple.
Cependant on retient surtout de ce siècle le travail poétique ambitieux mené par La Pléiade.
Les poètes de La Pléiade ont marqué l'histoire de la poésie française et même le vocabulaire de la langue française. Influencés par les oeuvres des poètes de l'Antiquité et les textes d'un poète italien du XIVe siècle nommé Pétrarque, les poètes de La Pléiade veulent produire une poésie française de grande qualité, aussi belle que la poésie latine qu'ils admirent.
Ronsard, Du Bellay et quelques autres poètes composent alors des poèmes lyriques, entre autres sous forme de sonnets en alexandrins.
Ronsard se lance d'autre part dans une poésie engagée, défendant ses convictions religieuses catholiques dans un contexte de guerre civile ; Agrippa d'Aubigné crée quant à lui une poésie baroque lyrique et engagée, côté protestant.
Un poète dans sa vieille mansarde qui prend l'eau
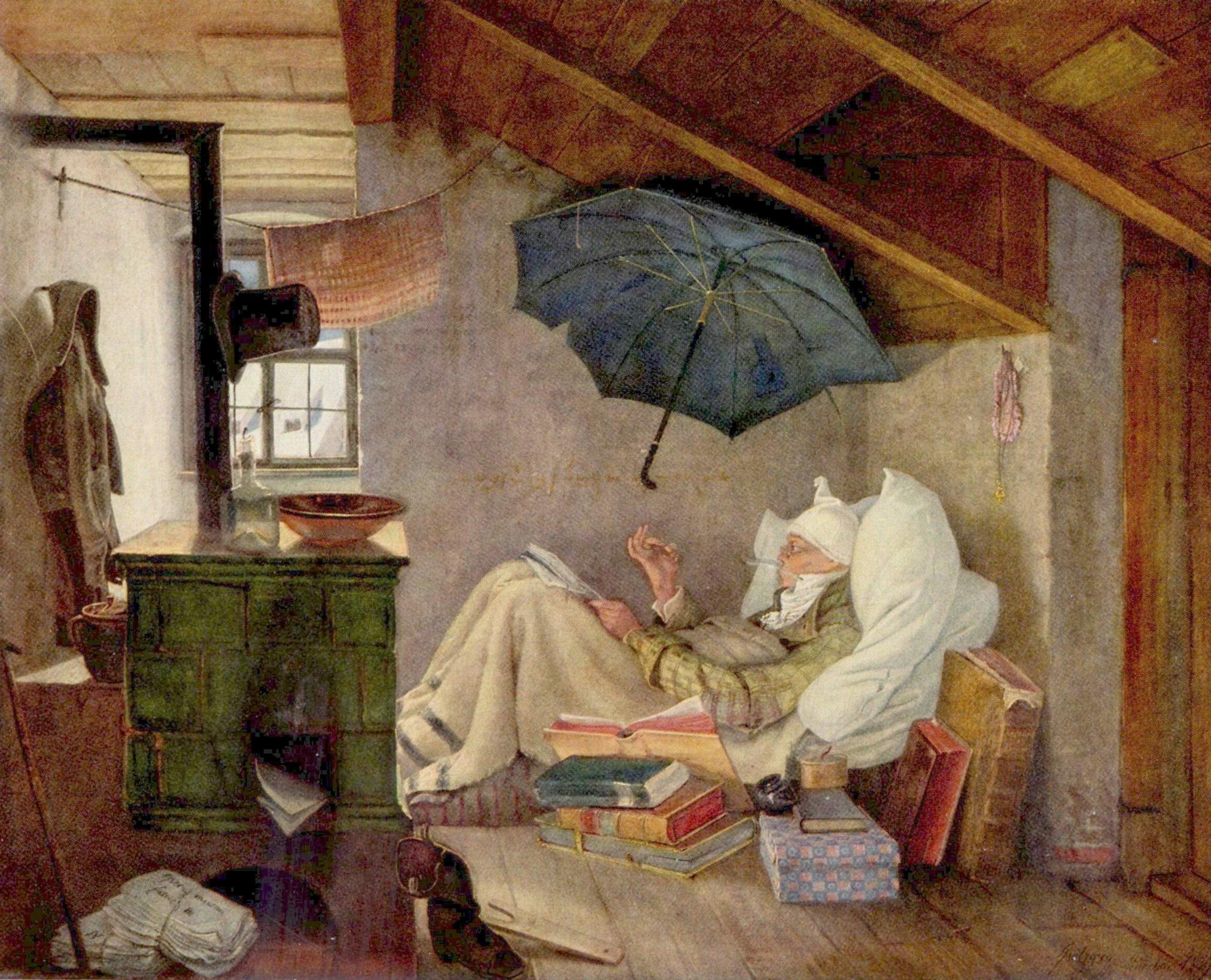
Au XVIIe siècle
Dans la première moitié du siècle, une poésie tourmentée et précieuse s'exprime dans le mouvement baroque sous la plume de poètes tels que Sponde, Saint-Amant, Marbeuf, Durand et Voiture.
La seconde moitié du siècle est dominée par le mouvement classique. C'est l'époque de la rigueur, avec l'alternance des rimes que suivaient déjà les poètes mais qui sont hissées au rang de règles. Les poètes respectent en effet une alternance entre rimes féminines (avec des mots qui se terminent en -e) et rimes masculines (avec des mots qui se terminent par un son autre que -e). La rime doit être valable autant pour l'oreille (quand on prononce le poème à voix haute) que pour l'oeil (quand on lit le poème).
Le poète François de Malherbe est un représentant typique de cette poésie classique.
Toutefois la poésie se retrouve aussi dans d'autres genres littéraires : au théâtre dans les tragédies de Corneille et Racine et dans certaines grandes comédies de Molière ainsi que dans les fables de Boileau et de La Fontaine.
Au XVIIIe siècle
Ce siècle est surtout marqué par la littérature d'idées. Pourtant la postérité a retenu le nom d'un poète : André Chénier.
Au XIXe siècle
La poésie romantique
Au XIXe siècle, Alphonse de Lamartine publie en 1820 un recueil de poèmes dans lequel la musicalité et le lyrisme paraissent particulièrement innovants : Méditations poétiques. Ce recueil est très important dans l'histoire de la poésie et même de la littérature française : il marque le début du mouvement romantique. Le poète y exprime des sentiments de nostalgie et se trouve en communion avec la nature.
Parmi les poètes romantiques on peut citer Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Gérard de Nerval et bien entendu Victor Hugo. Cette poésie est principalement lyrique mais peut aussi être une poésie engagée, selon les textes et les auteurs.
La poésie post-romantique
A partir de 1850 et en parallèle de la poésie romantique, une poésie réaliste se développe mais la postérité ne l'a pas vraiment retenue. En revanche, on remarque que si certains continuent de produire une poésie très romantique, comme Victor Hugo par exemple, d'autres artistes cherchent à trouver de nouvelles voies plus audacieuses.
Le mouvement de « l'art pour l'art » s'affirme avec les poèmes de Théophile Gautier, Leconte de Lisle et José-Maria de Heredia. Les mythes antiques sont repris et explorés avec un vocabulaire érudit et une écriture ciselée dans le but d'atteindre une beauté pure.
Dans cet esprit, Charles Baudelaire marque l'histoire de la poésie française avec ses Fleurs du Mal parues en 1857. Dandy refusant la grossièreté de son époque, il n'hésite pas à prendre des thèmes non poétiques puisés dans le quotidien et la ville pour y poser un regard raffiné.
Sa poésie est complexe car elle réunit différentes influences. Baudelaire aimerait en effet atteindre un Idéal de cette beauté pure caractéristique des aspirations de « l'art pour l'art », mais chez lui cet idéal est à la fois esthétique et spirituel. Cependant il est encore très influencé par le romantisme et l'importance de la nature avec le paysage-état d'âme. En même temps, il apprécie la force du réalisme qui observe sans ciller la réalité de son environnement y compris dans ses aspects laids et repoussants, a priori non poétiques. D'ailleurs il se sent attiré par le Mal qu'il matérialise par l'amour charnel, la prostitution, la ville, le vin, le blasphème. C'est alors qu'il invente une nouvelle voie symbolique : une attention particulière aux effets d'échos, à la représentation pour exprimer des idées.
Printemps des Poètes A FREJUS

A la fin du XIXe siècle, Paul Verlaine revendique quant à lui une poésie très légère et musicale, relevant du symbolisme et donnant la part belle aux vers impairs, c'est-à-dire aux vers comprenant un nombre impair de syllabes, précisément pour la musicalité qu'ils apportent.
Stéphane Mallarmé est un poète innovant de cette époque : appartenant lui aussi au mouvement symbolique, il jette les bases de la poésie moderne en s'éloignant du sens des mots pour les placer visuellement sur la page.
Autre poète qu'on retient de cette fin du XIXe siècle : Lautréamont, qui porte un regard critique et sombre sur les romantiques.
Enfin le poète Arthur Rimbaud présente une production sur peu d'années mais qui marque l'histoire de la poésie française autant par ses poèmes que par sa réflexion sur la poésie, notamment une lettre écrite à Paul Demeny qu'on appelle « La lettre du Voyant » dans laquelle il affirme que « Je » est un autre et qu'il veut devenir poète en se faisant l'âme monstrueuse.
S'exprimant à travers des sonnets en alexandrins mais osant aussi le vers libre, Rimbaud mêle ainsi une réelle fraîcheur du regard, une jeunesse de nouvelles images et des envies de révolte contre les normes bourgeoises catholiques de son époque.
Au XXe siècle
Début du XXe siècle
Le début du XXe siècle confirme la naissance d'une poésie moderne libérée des contraintes du vers et de la rime.
Dans les années 1910 – 1915, Guillaume Apollinaire, influencé par le cubisme de Picasso, envisage la poésie comme s'il était peintre et joue avec la disposition des mots sur la page. Choisissant de supprimer la ponctuation, il crée des calligrammes ou idéogrammes lyriques qui invitent à prendre en considération l'aspect graphique du poème autant que les sonorités et son contenu. Dans ses recueils Alcools et Calligrammes, les thèmes abordés sont liés à l'actualité de son époque et à toutes les nouveautés qui apparaissent : la ville en plein développement, la tour Eiffel, la radio... mais aussi la première guerre mondiale avec les obus et les tranchées. Le lyrisme se fait moderne et s'ancre sans complexe dans la réalité du quotidien.
La poésie de Blaise Cendrars se situe dans la même démarche. En revanche le poète Paul Valéry tend plutôt vers une perfection formelle presque philosophique, à rapprocher du symbolisme.
Dans les années 1920 – 1945, le mouvement surréaliste mené par André Breton se réclame de Rimbaud et d'Apollinaire mais aussi des travaux de Freud en psychanalyse. Adoptant le vers libre, les poètes surréalistes tels que Robert Desnos et Philippe Soupault explorent l'inconscient et les associations d'idées dans des jeux grammaticaux de « cadavres exquis » ou de libération de l'esprit en écriture automatique, toujours dans le but de créer des étincelles, des images étonnantes.
Les poètes Paul Eluard et Louis Aragon sont également des noms à retenir de cette époque et de ce mouvement surréaliste. Outre des poèmes lyriques à tonalité autobiographique, ils ont écrit des poèmes engagés pendant la résistance.
Des poètes surréalistes tels qu'Aimé Césaire et Léopold Senghor revendiquent quant à eux une poésie nouvelle pour célébrer la culture noire dans un mouvement qu'ils appellent eux-mêmes « la négritude ».
Deuxième moitié du XXe siècle
Au cours du XXe siècle, on observe différentes tendances.
Le dramaturge–poète Claudel et le poète Saint-John Perse composent des vers libres particulièrement longs, sorte de paragraphes puisque les douze syllabes sont dépassées, et qu'on appelle des versets.
Jacques Prévert écrit une poésie riche en images, très marquée par le surréalisme dont il a fait partie, et qui rencontre un grand succès auprès du public.
Ancien surréaliste lui aussi, Francis Ponge développe sa poésie à travers le poème en prose, notamment dans son recueil Le parti pris des choses paru en 1942 : s'appuyant sur l'observation, la décomposition, les images et l'étymologie, il pose un nouveau regard sur l' « objet » et en fait un « ob-jeu » afin d'emmener le lecteur à l' « ob-joie ».
D'autres poètes du XXe siècle sont à retenir ; nous ne pouvons pas tous les étudier ici et la fiche est déjà longue mais citons par exemple Jules Supervielle, René Char, Henri Michaux, Jean Tardieu, René-Guy Cadou, Claude Roy, Eugène Guillevic, Michel Deguy...
Au XXIe siècle
Aujourd'hui la poésie continue d'exister et de se développer : à travers les chansons, à travers le Slam, des essais de « poésie sonore » assistée par informatique mais aussi dans des recueils composés par exemple par Philippe Jaccottet ou bien Jacques Roubaud ou encore Yves Bonnefoy.

À l’occasion du Mois de la poésie, qui bat son plein à Québec, le Bureau des affaires poétiques présente, en collaboration avec Le Devoir, le volet « Brèves incursions ». Denise Desautels poursuit cette série qui, chaque semaine, donnera à lire un poème inédit d’un auteur du Québec.
À Hélène Monette, pour sa voix et pour tenter de mettre « à mal les dégâts du silence »
déjà tes « grandes ailes »
bien avant Thérèse pour joie et orchestre
« trop lourdes pour ta charpente »
tu lui ressemblais
presque toi
celle qui trop tôt
ne serait jamais plus là
« plus personne »
˚
presque toi
— celle que je n’ai jamais vue
tes récits de rues de rivières de doute
tes doigts de bleu sombre
et nos aimées nos cadavres
au creux de nos soifs
frémit la perte
comment l’entrer dans le poème
˚
la nuit menace
comme si elle aboyait
nos muscles d’espoir broyé
plus de place pour les anges
ni feu ni transbordement
de joie de déesses tu dis
« La beauté est laide, il faut rêver »
rien alentour n’est assez vaste
˚
es-tu encore là
haute hurlante Hélène
sauvage
figure de proue
sur fleuve de cendre à l’affût
« déguisée en espérance »
nos coeurs boitent
c’est qu’on est à court d’extase ici
˚
dernière chance d’avril
avançons
fils de fer et visages parallèles
à fleur de nous Hélène
le monde n’en finit pas de trembler
ton brouillard ton dernier baiser
black-out
sur une joue d’océan
˚
à côté de ce qui nous lie
l’infini turquoise
te parle nageuse de nuit
fouille nos hasards nos archives
ne sais rien vois pense prends peur
aloès palmiers foule dévalent
« la vie tient à si peu »
suis désolée
˚
sur le qui-vive
désolée
devant mornes et flamboyants
le réel en larmes va
on vit mal tout près du sol
dangereusement de trop
morsure amie
partout Dieu sourd consent
˚
une lumière et ses bras de silence
d’éternels débris de chute
« la petite espérance » ne marche plus
qu’os nomade qu’attentat
éclat sur la table d’horizon
tant bien que mal
– flèche spirale urne
la langue erre
˚
te parle tout près
sans adieu
brûle de vagues
de sons d’âmes d’immondices
pourtant nous veille
rêve
dis viens poème
petite paix
Montréal — Haïti

Denise Desautels