air amis amour animal animaux art article artiste background belle blog bonne
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· DIAPORAMA-PPS (817)
· ARTS ORIGINAL (1498)
· ARTISTES PEINTRES-DESSINATEURS (1156)
· PHOTOGRAPHES CONFIRMES (1388)
· ANIMAUX DIVERS (1161)
· MON AMI CLAUDE-VIDEOS-BLOGUES (1991)
· CHANSON-UNE CHANSON UNE HISTOIRE (923)
· MON AMIE MONIQUE D.-VIDEOS-BLOGS (1795)
· HUMOUR SEXY-BLAGUES (299)
· PARIS LIEUX ET MONUMENTS (1026)
bonjour josy merci a toi ,je ne sais pas qui tu es mais c'est gentilde venir me saluer a mon tour de te souh
Par photocosmos, le 22.11.2025
bonjour je viens te souhaiter une excellente journée bise de josy
Par Crystal46 , le 22.11.2025
ce n'est pas "à la lippe indolente" mais "à la lippe zinzolin". ne serait-ce que pour la rime avec "aquilin"..
Par Anonyme, le 20.11.2025
elle est super belle rayonnante dans une telle tenue meri anonyme ! http://photoco smos.centerblo g.net
Par photocosmos, le 20.11.2025
une anecdote intéressante sur la résistance individuelle des français face au nazisme.
comm e quoi il est enc
Par Anonyme, le 20.11.2025
· RETROUVEZ VOTRE PHOTO D'ECOLE
· PERE NOEL ET L'HUMOUR
· LES PLUS BEAUX VILLAGES D'ITALIE
· UNE CHANSON COQUINE
· humour sexy
· BERNARD BUFFET PEINTRE FRANCAIS-1
· DESSINS COQUINS SEXY HUMOUR
· POEME DE JACQUES CHARPENTREAU
· COLLECTION VETEMENTS POUR CHATS
· Nadine Morano filmée en plein ébat sexuel
· NAZARE AU PORTUGAL
· HUMOUR HI HI LES 10 COMMANDEMENTS CORSES
· TAJ MAHAL HISTOIRE
· alison botha miraculée !
· LES PLUS BEAUX YEUX DU MONDE-1
Date de création : 20.01.2011
Dernière mise à jour :
25.11.2025
49374 articles
CATHEDRALES-ABBAYES-COUVENTS
LA RUSSIE CATHEDRALE SAINT ISAAC A SAINT PETERSBOURG
LA RUSSIE CATHEDRALE SAINT ISAAC A SAINT PETERSBOURG
La cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, est une cathédrale orthodoxe russe bâtie sous les règnes des empereurs Alexandre Ier (1801-1825), Nicolas Ier (1825-1855) et Alexandre II (1855-1881). Elle a été inspirée par la cathédrale Saint-Paul de Londres.
C'est une des plus vastes cathédrales à dôme du monde avec 111 mètres de long, 97 mètres de large et 101,5 mètres de haut, soit 10 767 m2. C'est par ses dimensions, la troisième cathédrale d'Europe après Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul à Londres. Chaque colonne positionnée à l'avant de la cathédrale est d'une masse de 114 tonnes ; il a fallu un total de 45 minutes pour les ériger à l'aide d'un système de palan.
Elle est conçue pour accueillir 14 000 fidèles.
l'Empereur Alexandre Ier a lancé un concours pour la construction de la cathédrale qui a été remporté par l'architecte français Auguste Ricard de Montferrand, un élève de Charles Percier.
L'édifice a été construit entre 1818 et 1858, avec des techniques d’ingénierie innovantes. Plus de 100 types de nuances de granit, de marbre, de malachite et de lazulite ont été utilisés pour sa décoration.
La cathédrale a été consacrée le 30 mai 1858, jour de la fête de saint Isaac de Dalmatie, qui était aussi le saint patron de Pierre le Grand5, en présence de l'empereur Alexandre II .
Elle était le centre de la vie religieuse de Saint-Pétersbourg jusqu'au début des années 1920.
Après la révolution d'Octobre 1917, elle est pillée par les bolcheviks, ses objets de culte sont confisqués et ses cloches fondues.
La cathédrale est fermée sur ordre des autorités communistes en juin 1928 et transformée en 1931 en musée de l'athéisme jusqu'en 1937, où elle devient un musée d'histoire et de l'art.
En juin 1990, peu avant la chute de l'Union soviétique, les offices religieux ont repris dans la cathédrale, après une longue interruption forcée.
En 2013, une nouvelle cloche de 10 tonnes a été montée à l'un des clochers de la cathédrale.
St. Isaac's Cathedral Interior
CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE
cathédrale catholique romaine située dans la ville de Tulle, en Corrèze.
En 1103 l'abbé Guillaume, voulant donner à son abbaye, alors en pleine prospérité, un cadre digne d'elle, entreprend de reconstruire l'église et les bâtiments claustraux.

La cathédrale actuelle a été bâtie à partir du XIIe siècle, à l’emplacement d’une abbaye mérovingienne dont les titulaires avaient acquis la dignité épiscopale. La construction de l'abbatiale, actuelle cathédrale, et de son abbaye débuta selon un plan classique bénédictin. Les retards pris dans la construction firent évoluer les plans par rapport à ceux initialement prévus, passant du style roman au style gothique, notamment le cloître du XIIIe siècle qui abrite aujourd'hui le musée des arts et traditions populaires .

Les piliers et les collatéraux, voûtés d'arêtes, sont romans tandis que la voûte d’ogives de la nef est gothique. À l’extérieur, le portail ouest de style limousin est orné d'un arc polylobé.

Le clocher surmonté de sa longue flèche culminant à 75 mètres, date des XIIIe et XIVe siècles. Il est constitué de trois étages surmontés d'une élégante flèche octogonale, entourée de gracieux clochetons ; touchée par la foudre en 1645, cette flèche qui datait du XIVe siècle a été restaurée dans son style primitif.
En 1796, la cathédrale se voit amputée de son transept et de son chœur, et fermée à l'est par un mur droit. Elle fut réduite à une nef de six travées, bordée de collatéraux, fermée à l’est par un mur droit.

On peut remarquer les deux grandes châsses dites « à transept » des XIIe et XIIIe siècles, ainsi qu'une statue du XVIe en bois de châtaignier peint, représentant saint Jean Baptiste, qui autrefois était portée en tête de la « procession de la Lunade »3 qui avait lieu le 23 juin.

La décoration intérieure est d'une élégante sobriété, mise en valeur par la luminosité qu'apportent les grandes baies.
L’orgue néo-classique (construit par Abbey en 1839, restauré par Haerpfer et Hermann en 1975) est entretenu par un facteur corrézien, Bertrand Cattiaux.



BEAUVAIS-HORLOGE ASTRONOMIQUE
BEAUVAIS-HORLOGE ASTRONOMIQUE

L'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (Oise, Picardie, France), est considérée comme un chef-d'œuvre du genre, construite par Auguste-Lucien Vérité au XIXe siècle.
L'horloge astronomique a été construite entre 1865 et 1868 à la demande de l'évêque de Beauvais Joseph-Armand Gignoux par Auguste-Lucien Vérité, célèbre maître horloger de Beauvais (concepteur de l'Horloge astronomique de Besançon entre 1857 et 1862).

Elle compte environ 90 000 pièces mécaniques en acier et en laiton, 52 cadrans en émail et 68 automates1.
Elle fut d'abord présentée au palais de l'Industrie en 1869 avant d'être placée dans la chapelle du Saint-Sacrement, située dans le bras nord du transept de la cathédrale en 1876.

Elle est constituée d'un meuble exécuté selon les plans du Père Piérart, frère des Écoles chrétiennes. Ce meuble, de style romano-byzantin, mesure 12 m haut, 5,12 m de large sur 2,82 m de profondeur. Elle fut restaurée complètement en 1980 par cinq Meilleurs Ouvriers de France.

Sa décoration est inspirée de la Bible catholique. Sur la façade principale, comme sur les deux façades latérales, se trouvent des cadrans (52 en façade). Ils donnent la mesure du temps dans l’Univers ainsi que la représentation des principaux phénomènes astronomiques dont :
Le cycle solaire, le nombre d'or, les épactes, les lettres dominicales, l’indiction romaine, l'heure sidérale, l'équation solaire, la déclinaison du soleil2... En partie haute, 68 automates s'animent lors de la scène du Jugement Dernier. Un son et lumière, diffusé en cinq langues, explique le fonctionnement de ces automates durant 25 minutes, à l’aide de casques individuels. Quelques instants avant l'heure, le coq chante et bat des ailes. Quand l’heure sonne, le Christ, assis dans sa gloire, fait signe aux anges de jouer de la trompette. Bientôt le jugement a lieu, la Vertu est conduite au ciel par un ange, tandis que le Vice est poussé en enfer par un diable hideux.

(60) Beauvais Horloge Astronomique de la... par cc18c
CATHEDRALE SAINT AUBAIN DE NAMUR
CATHEDRALE SAINT AUBAIN DE NAMUR-BELGIQUE

Sa construction a été entreprise en 1751 et terminée en 1767. La consécration a eu lieu le 20 septembre 1772. Son patron est Alban de Mayence. Elle fait partie du Patrimoine majeur de Wallonie

La fondation du Chapitre Saint-Aubain fut initiée par la maison comtale de Namur, entre 1047 et 1051. Originellement situé hors des murs de la ville (la troisième enceinte l'englobera entre le XIIIe et le XIVe siècle), l'édifice était intégré dans un faubourg comprenant notamment le logement des chanoines et leurs lieux de réunion, un petit quartier de servants attachés au collège et un cimetière. Peut-être ce quartier a-t-il même disposé d'une enceinte, réellement efficace ou seulement symbolique.
Un projet d'aménagement de parc de stationnement souterrain sous l'actuelle place Saint-Aubain donnerait aux archéologues l'occasion d'en savoir plus sur l'organisation de ce faubourg, mais rien n'a été décidé au niveau communal, tant les inconvénients liés aux travaux d'aménagement seraient délicats à imposer à la ville et à ses habitants.

Le 12 mai 1559, le pape Paul IV crée le diocèse de Namur. Le premier évêque, un dominicain du nom d'Antoine Havet, est sacré en 1562. Il choisit pour cathédrale la collégiale Saint-Aubain, fondée en 1047, dont il subsiste encore une ancienne tour datant du XIIIe siècle (surélevée en 1648).

En 1740, de grosses inondations endommagent la cathédrale fort démodée, trop petite et déjà modifiée plusieurs fois. Le chapitre et l'évêque de Berlo de Franc-Douaire décident alors d'en faire construire une nouvelle. Ils s'adressent à Gaetano Matteo Pisoni, architecte italien qui a reconstruit le Palais de Charles de Lorraine à Bruxelles.

Les travaux, confiés à Jean-Baptiste Chermanne, consistent à unir la tour surélevée en 1648, seule partie de la collégiale conservée, et l'église paroissiale Saint-Jean l'évangéliste en une seule construction surmontée d'une grande coupole. La première pierre est posée le 24 juin 1751. La nouvelle cathédrale est terminée seize ans plus tard, la construction de la coupole ayant posé quelques problèmes. La consécration a lieu cinq ans après, le 20 septembre 1772.

Réalisée en calcaire de Seilles, la façade s'effrite au XIXe siècle, et est entièrement reconstruite peu avant 1900, de manière plus austère.
La cathédrale Saint-Aubain est d'un style mêlant, baroque, rococo et classicisme, comme beaucoup d'édifices du milieu du XVIIIe siècle. L'architecte, Pisoni, bâtira une autre cathédrale du même style, à Soleure (Suisse), en 1763, avec de plus gros moyens. La cathédrale de Namur n'est pas orientée d'est en ouest comme le voulait la tradition architecturale chrétienne (l'usage s'étant perdu dès le XVIe siècle) mais bien d'ouest en est. Son plan forme une croix latine. Les bras du transept, peu saillants, sont arrondis, tout comme l'abside.


CATHEDRALE DE VIENNE FRANCE
CATHEDRALE DE VIENNE FRANCE
BONJOUR AUX HABITANTS DE VIENNE
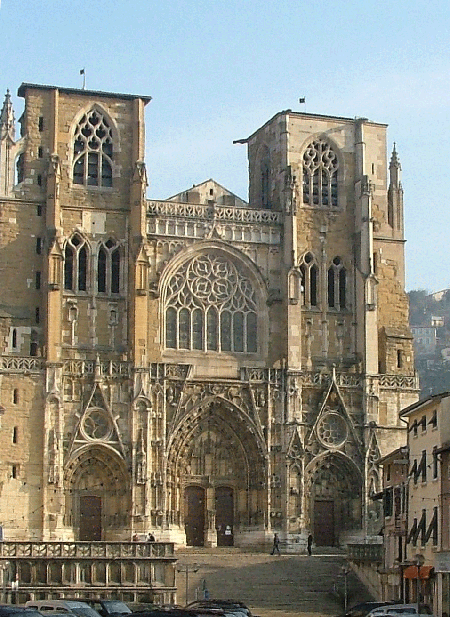
JE CONNAIS TRES BIEN CETTE CATHEDRALE AINSI QUE LA VILLE DE VIENNE,RICHE EN VESTIGES DU PASSE.
J'AI HABITE PROCHE A UNE EPOQUE ,OU SE TROUVE ENCORE UNE PARTIE DE MA FAMILE EN REMONTANT VERS LYON.
TOUT PRET DU FLEUVE LE RHONE ,VIENNE EST UNE VILLE TRES ANCIENNE ET AUSSI PASSAGE OBLIGE POUR REPRENDRE L'AUTOROUTE DU SOLEIL.
UNE VISITE DE LA VILLE SI VOUS PASSEZ DANS LA REGION. PETIT CONSEIL SE GARER ASSEZ LOIN DU CENTRE VILLE

L’église Saint-Maurice de Vienne est l’ancienne cathédrale du diocèse de Vienne, mentionné dès 314 et supprimé à la Révolution en 1790. Jusqu’à cette date, la cathédrale était également le siège de la Primatie des Sept Provinces. L’église fait actuellement partie du Diocèse de Grenoble-Vienne.

La cathédrale Saint-Maurice fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840

.
La cathédrale de Vienne occupe le même site depuis le IVe siècle, mais aucune trace de construction antérieure au Xe siècle ne subsiste. La cathédrale est reconstruite entre 1030 et 1070 environ par l’archevêque Léger.
La construction du bâtiment actuel est entreprise en 1130 dans le style roman. De cette époque datent les parties les plus anciennes, à savoir la partie de la nef comprise entre les 5e et 11e travées. L’édification se poursuit au XIIIe siècle : le style devient alors gothique, comme en témoigne le chœur, le début et les parties hautes de la nef. Le nom de Guillaume de l’Œuvre est avancé comme architecte. La cathédrale est consacrée par le pape Innocent IV sous le vocable de Saint-Maurice, le 20 avril 1251. La construction se poursuit jusqu’au XVIe siècle avec notamment l’élévation de la façade. La dernière pierre est posée en 1529.
Par la suite, l’édifice a beaucoup souffert des guerres de Religion au XVIe siècle. Les huguenots détruisent notamment la plupart des vitraux et l’ensemble des sculptures de la façade le 20 mars 1562. Pendant la Révolution, l’église est transformée en grenier à foin et en caserne. L’église est rendue au culte en 1802 mais les deux cloîtres et trois chapelles sont détruites en 1803–1804, pour restructurer le tissu urbain aux alentours. Le palais épiscopal est détruit à la même période. Enfin, la tour Nord est victime du feu en 1869.
Œuvres d'art
La cathédrale est riche en œuvres d'art, parmi lesquelles on peut citer :
Mausolée des archevêques de Vienne Armand de Montmorin et Henri-Oswald de la Tour d'Auvergne

Une série de tapisseries flamandes de la fin du XVIe siècle qui retracent des épisodes de la vie de saint Maurice. Elles sont au nombre de cinq et sont accrochées autour du chœur.
Un vitrail du XVIe siècle dans le chevet du collatéral droit. Ce vitrail est le seul vitrail antérieur au XIXe siècle de la cathédrale. Il représente l'Adoration des Mages dans la partie supérieure. Dans la partie inférieure sont représentés saint Maurice à droite et saint Jacques à gauche qui encadrent le donateur agenouillé, accompagné de son saint patron, saint Antoine.

Une châsse-reliquaire conserve les ossements de Saint Maurice d'Agaune († 287).
Un très bel ensemble d'une soixantaine de chapiteaux romans de la première moitié du XIIe siècle représentant soit des scènes historiées (le Roi David musicien, les Saintes Femmes au tombeau,…), soit des décors végétaux.
Des groupes sculptés du XIIIe siècle provenant sans doute de l'ancien jubé. On remarque notamment dans la nef de gauche au-dessus d'une porte un bas-relief représentant les Rois Mages devant Hérode et dans la nef de droite un bas-relief représentant l'Adoration des Mages.
Dans le porche nord, trois statues monumentales du milieu du XIIe siècle représentent trois apôtres et témoignent des échanges artistiques entre Vienne et Autun à cette période
Le mausolée des archevêques de Vienne Armand de Montmorin et Henri Oswald de La Tour d'Auvergne, dans le chœur à droite. C'est une œuvre du sculpteur Michel-Ange Slodtz. Elle a été commandée en 1740, réalisée à Rome et livrée à Vienne en 1747. Les deux archevêques sont figurés, l'un allongé sur le sarcophage, l'autre venant vers lui. C'est une œuvre importante de la sculpture funéraire en France au XVIIIe siècle.
Le maître-autel, réalisé également par Michel-Ange Slodtz, avec des marbres antiques venant de Rome. C'est le seul autel antérieur au XIXe siècle de la cathédrale.
Dans le mur de l'abside centrale se dresse le siège épiscopal ou cathèdre en pierre du XIIIe siècle.
CATHEDRALE DE PALMA DE MAJORQUE






CATHEDRALE SAINT-BENIGNE DE DIJON
CATHEDRALE SAINT-BENIGNE DE DIJON
La cathédrale Saint-Bénigne de Dijon est une cathédrale de style Gothique du XIIIe siècle de Dijon en Côte-d'Or en Bourgogne, dédiée à saint Bénigne de Dijon (martyr chrétien du IIe siècle).
SARCOPHAGE DE SAINT BENIGNE
Abbatiale de l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon (VIe siècle), elle est classée aux monuments historiques depuis 18621 et la crypte est classée aux monuments historiques depuis 1846.
En 511 sous le règne du roi Mérovingiens Clovis Ier, l'évêque saint Grégoire de Langres fait construire la crypte pour y déposer le sarcophage de saint Bénigne de Dijon (martyr chrétien du IIe siècle). Une basilique consacrées à Saint Bénigne en 535, est construite sur la crypte.
En 871 l'évêque de Langres Isaac fonde l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon régie par la règle de saint Benoît avec pour abbatiale l'église Saint-Bénigne de Dijon.
Entre 1280 et 1393 la « cathédrale Saint-Bénigne de Dijon » est construite en style gothique sur la précédente basilique effondrée (voir abbaye Saint-Bénigne de Dijon) avec pour crypte l'étage inférieur de la rotonde, détruite en 1792.

De 1025 à 1030, Saint-Bénigne accueille le moine Raoul Glaber (un des principaux chroniqueurs de l'An mil).
Le 31 juillet 1479, la cathédrale est témoin du roi Louis XI de France qui confirme sa protection royale pour la ville de Dijon.
La chapelle Sainte-Marie est une trace encore visible de la campagne de restauration menée par l'évêque de Langres Isaac en 871. La chapelle terminale de l’église souterraine est signalée dès 938. Elle possède une salle presque carrée (4,70 m x 4,25 m x 3,70 m de hauteur) voûtée en plein cintre.
Trois baies juxtaposées sont ouvertes dans l’axe de la pièce; les baies actuelles ont été restaurées en 1890. La chapelle est sans décoration. Sur la paroi nord, des pierres anciennes avec entrelacs carolingiens ont été enchâssées au XIXe siècle, tout comme la dalle tombale dans le mur sud, il s'agit de la dalle du moine Turpericus, de l’époque mérovingienne.

La basilique restaurée par Isaac est totalement rasée en l’an 1000.
L'évêque de Langres Brunon de Roucy établit en 989 l'Ordre de Cluny à l'abbaye Saint-Bénigne. À sa demande, Mayeul, Abbé de Cluny, y détache des « moines d'élite ». Douze moines arrivent à Dijon le 24 novembre 989. En 990, Guillaume de Volpiano, abbé de Cluny, est nommé abbé. Les bâtiments menacent de tomber en ruine.

Le 14 février 1002, la première pierre des nouveaux bâtiments est posée. Guillaume dirige lui-même les ouvriers venus d’Italie. Il s’agit de construire trois sanctuaires, sur l’emplacement des constructions du IXe siècle, composés d'une église souterraine, de l'abri du tombeau de saint Bénigne, d'une église au niveau du sol pour le culte, d'une rotonde au chevet des deux églises de trois étages. Ces trois constructions couvraient une longueur de cent mètres et une largeur de vingt-cinq mètres. L’étage inférieur de la rotonde (la crypte de la cathédrale) est le seul vestige actuel de cet ensemble.



CATHEDRALE DE TOURNAI EN BELGIQUE
CATHEDRALE DE TOURNAI EN BELGIQUE
Notre-Dame de Tournai est la cathédrale du diocèse de Tournai. Elle est le seul édifice religieux de Belgique qui ait été construit comme cathédrale. Chef d'œuvre du gothique scaldien, ce monument est, par l'alliance harmonieuse des styles roman et gothique et par sa taille et son architecture caractéristique, un des témoins les plus impressionnants de l'art d'occident. Elle fait partie du patrimoine majeur de Wallonie et est classée depuis l'an 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Trois cathédrales se sont succédé sur le site de la cathédrale Notre-Dame de Tournai. C'est au Ve siècle qu'une première cathédrale fut édifiée sous l'égide de saint Eleuthère, un des premiers évêques de la ville.
En 532, saint Médard, quatorzième évêque de Noyon — qui en 531 avait déplacé son siège épiscopal de Saint-Quentin à Noyon — fut élu évêque de Tournai. Il unit ainsi les deux sièges qui le resteront jusqu'en 1146, lorsque le pape Eugène III sépara de nouveau les deux diocèses.
Du IXe au XIe siècle on procéda à l'édification d'un nouveau sanctuaire. Ce dernier, incendié à deux reprises (en 881 et 1066) fut chaque fois restauré. En 1092, l'abbaye Saint-Martin de Tournai est fondée. C'est aussi l'année de la fin d'une « grande peste ». En commémoration de cet évènement s'établit la tradition de la « Grande Procession », qui a toujours lieu chaque deuxième dimanche de septembre.

Au début du XIIe siècle, le développement du culte de Notre-Dame, la prospérité de la ville, et peut être le désir de hâter la séparation des diocèses de Tournai et Noyon, poussèrent à la construction de l'actuelle cathédrale, la troisième. La construction se fit suivant une progression d’ouest en est, de la nef vers le chœur. Les charpentes furent réalisées de 1142 à 1150.

En 1146, l'évêché de Tournai fut séparé de celui de Noyon par décision du pape Eugène III.
Le nouvel édifice de style roman fut consacré le 9 mai 1171 ; nous en avons conservé à ce jour la plus grande partie.

En 1243, cependant, l'évêque Walter de Marvis entreprit la reconstruction du chœur. On procéda à la démolition de l'ancien chœur roman pour faire place au chœur gothique actuel construit en style rayonnant. En 1255 eut lieu la dédicace de ce nouveau chœur. Celui-ci est directement inspiré de ceux d'Amiens et de Soissons. De taille impressionnante, sa longueur équivaut à celle de la nef et du transept romans réunis.
C'est au début du XIIIe siècle que débuta la voûtaison du transept, et ce, sous l'impulsion de l'évêque Étienne. Cette phase fut suivie de l'achèvement de la tour-lanterne et des quatre autres tours.
Au début du XIVe siècle, on procéda à l'adjonction du porche occidental, de style gothique lui aussi.
Le 23 août 1566, la cathédrale fut mise à sac par les iconoclastes, qui détruisirent ainsi la plus grande partie de son décor médiéval. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française s'en prit à son tour à tout le mobilier intérieur, c'est-à-dire aux autels, aux marbres, aux cloches, aux stalles, etc. Rouverte au culte suite au concordat de 1801, une décoration digne de la splendeur du sanctuaire fut peu à peu reconstituée ou recréée. Deux évêques du XIXe siècle y contribueront avant tout : Monseigneur François-Joseph Hirn parvint à récupérer nombre d'œuvres d'art en provenance d'abbayes supprimées ou démantelées, comme le pavement du chœur et l'autel de l'abbatiale de l'abbaye Saint-Martin, tandis que Monseigneur Gaspard-Joseph Labis mit en route une grande restauration qui dura plus de quarante ans.

La Seconde Guerre mondiale causa également d'importants ravages. La ville de Tournai fut victime d'un intense bombardement allemand en mai 1940. La riche chapelle-paroisse Notre-Dame, de style gothique, qui datait du début du XVIe siècle et qui longeait tout le bas-côté nord de la nef romane, fut anéantie et, non reconstruite, a aujourd'hui disparu.

Après avoir subi une tornade le 14 août 1999, la cathédrale de Tournai a montré sa fragilité. Après des mesures visant à sa stabilisation, la ville de Tournai, Ideta, la Province du Hainaut et l'Évêché ont établi ensemble un projet de revitalisation de l'édifice et de son quartier afin de redéployer économiquement la Cité des Cinq Clochers grâce à ses atouts culturels et patrimoniaux.


CATHEDRALE SAINT MAURICE D'ANGERS
CATHEDRALE SAINT MAURICE D'ANGERS
L'œuvre est intermédiaire entre les styles roman et gothique. La cathédrale est un témoignage de l'art gothique angevin.
La cathédrale d'Angers fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862.
Au début du XIe siècle, l'évêque Hubert de Vendôme (1006-1047) fit construire une nouvelle cathédrale romane à nef unique. Cette nouvelle cathédrale fut consacrée le 16 août 1025. Mais à peine achevé, cet édifice brûla en 1032. L'évêque Geoffroy de Tours remit la cathédrale en état durant la seconde moitié du XIe siècle. L'autel du crucifix fut béni en 1051 et le nouveau maître-autel fut consacré en 1096 .
Peu après les évêques Renaud de Martigné (1102-1125) et Ulger (1125-1148) entreprirent la reconstruction de cette cathédrale. Celle-ci se déroula progressivement sous l'impulsion notamment des évêques Normand de Doué (1148-1153) et Guillaume de Beaumont (1202-1240).

Normand de Doué et Guillaume de Beaumont firent reconstruire la nef ainsi que le monumental portail face au parvis. La nef unique s'inspire de celles de la cathédrale d'Angoulême et de l'abbaye de Fontevraud.

Les structures de base des murs de la nef, de style roman, ont subsisté jusqu'à mi-hauteur. Ils ont reçu au milieu du XIIe siècle des colonnes et des voûtes d’ogives : c'est la naissance du gothique angevin. La nef romane à vaisseau unique ouvre ainsi sur un transept et un chœur gothiques — ce dernier a été aménagé en débord sur l'enceinte tardo-antique de la Cité.

Au XVIe siècle, l'architecte angevin Jean Delespine ajouta à la base des deux tours, la galerie des personnages représentant des chevaliers, compagnons de Saint-Maurice. Sur cette galerie, il fit élever, dans le style Renaissance, un deuxième niveau, ayant l'aspect d'une tourelle carrée surmontée d'un clocheton hexagonal .

La cathédrale d'Angers est constituée de deux flèches. La construction de la flèche nord se fit en 1518 et celle de la flèche sud en 1523.
En 1806, fut détruit pour raison de vétusté, un porche monumental qui s'élevait devant la façade de la cathédrale, face au parvis.

Ce porche, de style gothique angevin, placé devant le portail d'entrée, possédait deux niveaux. Reste de nos jours, quatre arcs d'ogive, seuls témoignages de cet ancien porche médieval.

Divers projets de reconstruction furent élaborés durant le XXesiècle, mais aucun d'entre eux n'aboutit

CATHEDRALE SAINT ETIENNE DE SENS
La cathédrale Saint-Étienne de Sens,
est une cathédrale catholique romaine française, située dans la ville de Sens du département de l’Yonne.
Elle est considérée comme la première des cathédrales gothiques (la basilique Saint-Denis qui lui dispute ce titre est consacrée en 1140, mais n’est pas à cette époque une cathédrale ; elle ne le devient qu’en 1966).

C’est vrai pour ce qui concerne la date de début des travaux (1135) et la date de sa consécration (1163). Sa tour ne fut cependant achevée que fort tard (1532–1534). Quant au transept, qui date des années 1490–1515, il constitue un des plus beaux chefs-d’œuvre du gothique flamboyant.

La cathédrale fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840.
Première grande cathédrale gothique de la chrétienté, l'influence de la cathédrale de Sens fut fort importante. Elle le fut particulièrement lors de la reconstruction en style gothique du chœur et du transept oriental de la cathédrale de Cantorbéry, suite à l'incendie de 1174. L'architecte chargé de ces travaux s'appelait d'ailleurs Guillaume de Sens et dirigea le chantier de 1175 à 1179 , date à laquelle il rentra en France, gravement blessé par une chute survenue sur le chantier.

Son successeur et élève, un certain anglais nommé William (Guillaume l'Anglais) termina le chœur, le chevet, la chapelle de la Trinité et la chapelle dite de la couronne de Becket. Or cette extrémité orientale conserve toutes les caractéristiques de l'abside de la cathédrale de Sens, non-seulement dans son plan, mais dans sa construction et sa sculpture d’ornement, avec plus de finesse et de légèreté, ce qui s’explique par l'intervalle de quelques années qui sépare la construction des deux édifices. Viollet-le-Duc émettait l'hypothèse que ce Guillaume de Sens aurait été également l'architecte (inconnu) de la cathédrale Saint-Étienne de Sens.

L'architecture de la cathédrale de Sens eut aussi une forte influence sur l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ainsi que sur la cathédrale de Nicosie à Chypre.
Peu après sa consécration en 1164, la cathédrale de Sens accueillit un prestigieux réfugié politique : l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket. Ce dernier était en conflit avec le roi d'Angleterre Henri II. Il resta en Bourgogne jusqu'en 1170 et séjourna aussi à l'abbaye de Pontigny. De retour en Angleterre, il se fit assassiner dans sa cathédrale de Canterbury le 29 décembre 1170.

Le 27 mai 1234, Saint-Louis, roi de France, épousa dans la cathédrale Saint-Étienne Marguerite de Provence, laquelle y fut sacrée reine le lendemain.
Le Dauphin Louis-Ferdinand, fils de Louis XV y est inhumé en 1765; bientôt suivi par son épouse Marie-Josèphe de Saxe.
La cathédrale n'a pas seulement souffert des affres des armées révolutionnaires de la république. Le XIXe siècle regorge de soi-disant spécialistes du gothique qui commirent bien des méfaits. Ainsi l'architecte-vandale Robelin, chargé de "restauration" de l'édifice, détruisit purement et simplement les chapelles latérales pour les remplacer par d'autres de sa conception…























